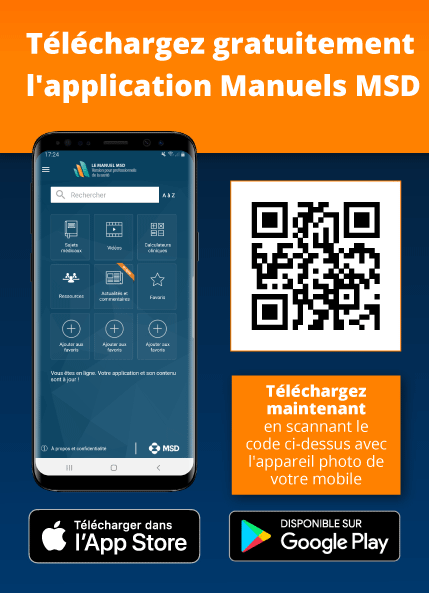L'hémoglobinose S–bêta-thalassémie est une hémoglobinopathie qui entraîne des symptômes similaires à ceux d'une drépanocytose, mais moins sévère.
(Voir aussi Revue générale des anémies hémolytiques.)
En raison de la fréquence accrue de l'hémoglobine (Hb) S (l'hémoglobine anormale qui est responsable de la drépanocytose) et des gènes de la bêta-thalassémie chez les personnes d'ascendance africaine, méditerranéenne ou sud-asiatique, l'hérédité des deux défauts est relativement fréquente. La bêta-thalassémie résulte d'une diminution de la production des chaînes bêta-polypeptidiques de l'hémoglobine due soit à des mutations, soit à des délétions du gène de la bêta-globine, ce qui entraîne une altération de la production d'hémoglobine A (voir aussi Thalassémies).
Des mutations de la bêta globine peuvent entraîner une perte partielle (allèle bêta+) ou une perte complète (allèle bêta 0) de la fonction bêta-globine. Ainsi, les manifestations de la S-bêta-thalassémie dépendent du fait que le patient ait ou non un allèle bêta + ou bêta 0. Ceux qui sont des allèles bêta + produisent des quantités variables de bêta-globine (et ont donc des quantités variables d'Hb A). Ceux qui sont bêta 0 ne produisent pas de bêta-globine et n'ont donc pas d'Hb A.
Cliniquement, les manifestations dépendent de la quantité d'Hb A. Ainsi, la thalassémie Hb-S-bêta 0 se manifeste de la même façon que la drépanocytose (Hb SS), alors que la bêta-thalassémie Hb S-bêta+ déclenche des symptômes d'anémie modérée et certains signes de la drépanocytose, mais habituellement moins fréquents et moins graves que ceux de la drépanocytose à hémoglobine SS. Une anémie microcytaire légère à modérée est habituellement présente, avec quelques globules rouges falciformes sur le frottis sanguin.
Le diagnostic nécessite des études quantitatives de l'hémoglobine. L'Hb S prédomine à l'électrophorèse et est toujours supérieure à 50%. L'Hb A est diminuée dans l'Hb-S-bêta + ou absente dans l'Hb-S-bêta 0. L'augmentation de l'HbF est variable.
Le traitement, si nécessaire (p. ex., pour une anémie symptomatique, des crises douloureuses, une maladie des organes finaux) est le même que le traitement de la drépanocytose.