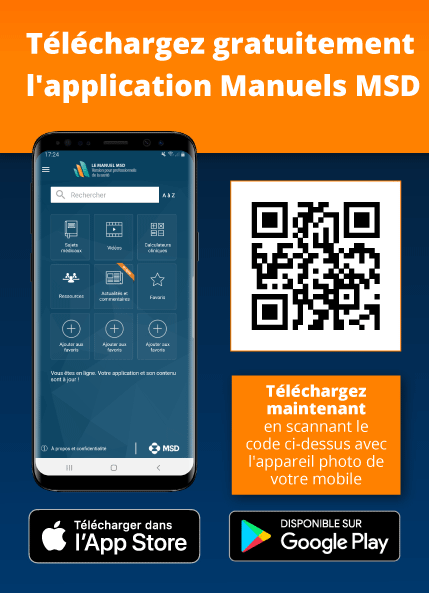Les maladies tubulo-interstitielles sont des troubles cliniquement hétérogènes qui ont en commun un tableau similaire de lésions tubulaires et interstitielles. Dans les cas sévères et prolongés, l'ensemble du rein peut être atteint, avec un dysfonctionnement glomérulaire et même une insuffisance rénale. Les catégories principales de maladies tubulo-interstitielles sont les suivantes
Néphrite tubulo-interstitielle aiguë ou chronique
La néphropathie secondaire à l'injection de produit de contraste est une nécrose tubulaire aiguë provoquée par un agent de contraste radiologique iodé, qui sont tous néphrotoxiques.
La néphropathie aux analgésiques, un type de néphrite interstitielle chronique, la néphropathie de reflux et le myélome rénal peuvent provoquer une néphrite tubulo-interstitielle chronique.
Les troubles tubulo-interstitiels peuvent également être la conséquence de troubles métaboliques et d'exposition à des toxines.
Physiopathologie des maladies tubulo-interstitielles
Les reins sont exposés à des concentrations anormalement élevées de toxines. Les reins sont le tissu qui reçoit l'apport sanguin le plus important (environ 1,25 L/min ou 25% du débit cardiaque), et les solutés non liés aux protéines quittent la circulation par filtration glomérulaire à une vitesse ≥ 100 mL/min; il en résulte que les agents toxiques sont délivrés à un taux égal à 50 fois celui d'autres tissus et dans des concentrations beaucoup plus élevées. Lorsque l'urine est concentrée, les surfaces apicales des cellules tubulaires peuvent être exposées à des concentrations de molécules 300 à 1000 fois supérieures à celles du plasma. La fine bordure en brosse des cellules tubulaires proximales représente une surface énorme. Un mécanisme de contre-courant intervient dans l'augmentation de la concentration ionique du liquide interstitiel dans la médullaire et (ainsi, augmente la concentration de l'urine) jusqu'à 4 fois la concentration du plasma.
En outre, certains facteurs peuvent influer sur la vulnérabilité cellulaire après l'exposition à des toxines:
Les mécanismes de transport tubulaire libèrent les médicaments de leurs protéines de transport, dont la liaison protège normalement les cellules de la toxicité.
Le transport transcellulaire expose l'intérieur de la cellule et ses organelles à des molécules chimiques nouvellement rencontrées.
Les sites de liaison de certains agents (p. ex., les groupes sulfhydryl) peuvent favoriser l'entrée, mais peuvent également retarder la sortie (p. ex., métaux lourds).
Des réactions chimiques (p. ex., alcalinisation, acidification) peuvent modifier le transport dans l'une ou l'autre direction.
Le blocage des récepteurs de transport peut modifier l'exposition des tissus (p. ex., la diurèse par blocage des récepteurs de l'adénosine A1 comme avec l'aminophylline peut diminuer l'exposition).
Les reins présentent la plus forte consommation de glucose et d'oxygène par gramme de tissu et sont donc vulnérables aux toxines qui affectent le métabolisme énergétique des cellules.