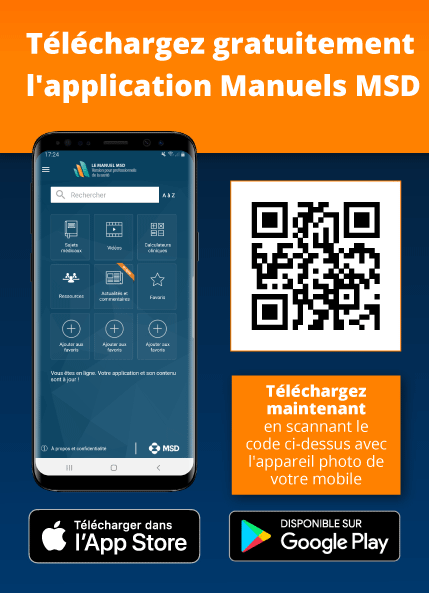Le syndrome de Claude Bernard-Horner comprend un ptôsis, un myosis et une anhidrose en rapport avec un dysfonctionnement de la voie sympathique au niveau cervical. Le diagnostic est confirmé par des tests pharmacologiques utilisant des gouttes oculaires de cocaïne ou d'apraclonidine. Une imagerie (IRM ou TDM) du cerveau, de la moelle épinière, du thorax ou du cou peut être nécessaire pour identifier la cause. Le traitement est celui de la cause.
(Voir aussi Revue générale du système nerveux végétatif.)
Étiologie du syndrome de Claude Bernard-Horner
Le syndrome de Claude Bernard-Horner apparaît lorsque la voie cervicale sympathique reliant l'hypothalamus à l'œil est interrompue. La lésion causale peut être primitive (notamment congénitale) ou secondaire à un autre trouble.
Les lésions sont habituellement classées comme étant soit:
Centrales (p. ex., ischémie du tronc cérébral, syringomyélie, tumeur cérébrale, tumeur de la moelle épinière)
Périphérique (p. ex., tumeur de Pancoast, adénopathies cervicales, lésions du cou et du crâne, dissection aortique ou carotidienne et l'anévrisme de l'aorte thoracique)
Les lésions périphériques peuvent être d'origine préganglionnaire ou post-ganglionnaire.
Symptomatologie du syndrome de Claude Bernard-Horner
La symptomatologie du syndrome de Horner combine ptôsis (paupière tombante), myosis (pupille contractée), anhidrose et hyperhémie du côté atteint.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Dans la forme congénitale, l'iris ne se pigmente pas et reste gris-bleu.
Diagnostic du syndrome de Horner
Instillation de gouttes oculaires de cocaïne ou d'apraclonidine
IRM ou TDM pour diagnostiquer la cause
L'instillation d'un collyre peut permettre de confirmer et de caractériser le syndrome de Claude Bernard-Horner.
Tout d'abord, des gouttes de cocaïne (4 ou 10%) ou d'apraclonidine (0,5%) sont mises dans les deux yeux:
Cocaïne: la cocaïne bloque la recapture synaptique de la noradrénaline et provoque la dilatation de la pupille de l'œil non affectée. En cas de lésion postganglionnaire (syndrome de Claude-Bernard-Horner périphérique), la pupille de l'œil affecté ne se dilate pas car les terminaisons nerveuses postganglionnaires ont dégénéré; le résultat est une anisocorie augmentée (taille inégale des pupilles). Si la lésion est supérieure par rapport au ganglion cervical supérieur (syndrome préganglionnaire ou central de Claude Bernard-Horner) et que les fibres postganglionnaires sont intactes, la pupille de l'œil affectée se dilate également et l'anisocorie diminue.
Apraclonidine: l'apraclonidine est un agoniste alpha-adrénergique faible qui dilate de façon minimale la pupille d'un œil normal. Si une lésion post-ganglionnaire est présente (syndrome de Claude Bernard-Horner périphérique), la pupille de l'œil affecté se dilate plus que celle de l'œil non affecté car le muscle dilatateur de l'iris de l'œil affecté a perdu son innervation sympathique et a développé une hypersensibilité adrénergique. Par conséquent, l'anisocorie diminue. (Cependant, les résultats peuvent être faussement normaux si la lésion responsable est aiguë.) Si la lésion est préganglionnaire (ou syndrome central de Claude Bernard-Horner), la pupille de l'œil affecté ne se dilate pas car le muscle dilatateur de l'iris ne développe pas de hypersensibilité adrénergique; en conséquence, l'anisocorie augmente.
Si les résultats suggèrent un syndrome de Horner, des tests supplémentaires sont effectués pour distinguer une lésion postganglionnaire d'une lésion centrale ou préganglionnaire.
Les patients qui souffrent du syndrome de Claude Bernard-Horner doivent subir une IRM ou une TDM du cerveau, de la moelle épinière, du thorax ou du cou (en fonction du contexte clinique) pour localiser l'anomalie.
Traitement du syndrome de Claude Bernard-Horner
Traitement de la cause
La cause du syndrome de Claude Bernard-Horner, si elle est identifiée, est traitée; il n'existe aucun traitement pour le syndrome de Claude Bernard-Horner primitif.
Points clés
Le syndrome de Claude-Bernard Horner provoque une ptose, un myosis et une anhidrose.
Il résulte d'une lésion centrale ou périphérique (préganglionnaire ou post-ganglionnaire) qui perturbe la voie sympathique cervicale, qui va de l'hypothalamus à l'œil.
Instiller de la cocaïne ou de l'apraclonidine dans les deux yeux pour confirmer le diagnostic du syndrome de Claude Bernard-Horner et localiser la lésion (préganglionnaire ou postganglionnaire).
Effectuer une IRM ou une TDM du cerveau, de la moelle épinière, du thorax ou du cou, en fonction du contexte clinique.
Traiter la cause, si identifiée; il n'y a pas de traitement du syndrome primaire de Claude Bernard-Horner.