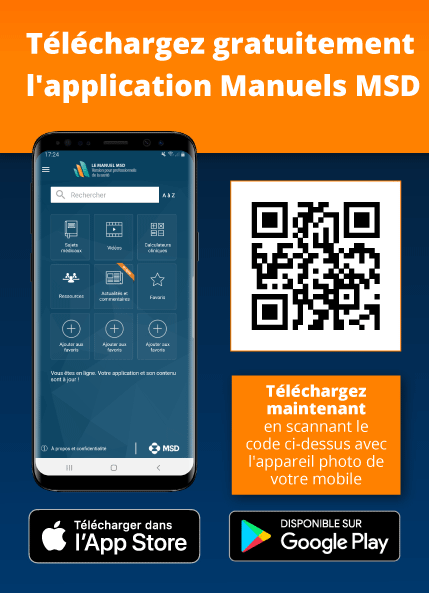Le syndrome de choc toxique est dû à des exotoxines staphylococciques ou streptococciques. Les manifestations associent une hyperthermie, une hypotension, une éruption érythémateuse diffuse et une atteinte polyviscérale, qui peuvent rapidement évoluer en choc sévère et hors de toute ressource thérapeutique. Le diagnostic est clinique et biologique par isolement du microrganisme responsable. Le traitement comprend une antibiothérapie, des soins intensifs et des Ig IV.
Le syndrome de choc toxique est provoqué par des cocci producteurs d'exotoxines. Les souches du groupe phagique 1 de Staphylococcus aureus élaborent la toxine TSS-1 (TSS = toxic shock syndrome, syndrome de choc toxique) (TSST-1 toxic shock syndrome toxin) ou d'autres exotoxines apparentées; certaines souches de Streptococcus pyogenes produisent au moins 2 exotoxines.
Syndrome de choc toxique staphylococcique
Les sujets les plus à risque de syndrome de choc toxique staphylococcique sont:
Les femmes qui ont une colonisation staphylococcique du vagin préexistante et qui laissent des tampons ou d'autres dispositifs (p. ex., coupes menstruelles, capes cervicales, dispositifs intra-utérins, éponges contraceptives, diaphragmes, pessaires) dans le vagin
Des facteurs mécaniques et chimiques liés à l'emploi des tampons sont suspectés d'augmenter la production de l'exotoxine ou de favoriser sa pénétration dans le courant sanguin par une brèche de la muqueuse ou via l'utérus. Des estimations suggèrent une incidence de 0,03 à 0,5 cas/100 000 personnes en bonne santé, et des cas sont encore rapportés chez des femmes qui n'utilisent pas de tampons et chez des patients après un accouchement, un avortement ou une intervention chirurgicale. La mortalité résultant du syndrome de choc toxique staphylococcique menstruel et non-menstruel (p. ex., chez les enfants) a été trouvée être inférieure à 1% ce qui est significativement plus bas que la mortalité dans le syndrome de choc toxique streptococcique (1).
Des cas de syndrome de choc toxique staphylococcique ont également été signalés chez l'homme et la femme porteurs de tout type d'infection par S. aureus.
Les récidives sont fréquentes chez la femme qui continue à utiliser des tampons ou d'autres dispositifs au cours des 4 mois suivant un épisode (2).
Choc toxique streptococcique
Le syndrome de choc toxique streptococcique est semblable à celui provoqué par Staphylococcus aureus, mais la mortalité est plus élevée (20 à 60%) malgré un traitement agressif. De plus, une bactériémie à Streptococcus pyogenes est fréquemment présente, et 50% ou plus des cas sont associés à des infections streptococciques profondes des tissus mous telles que la fasciite nécrosante ou l'érysipèle (ni l'une ni l'autre n'est fréquente avec le syndrome de choc toxique staphylococcique) (3). Les patients sont habituellement des enfants ou des adultes par ailleurs en bonne santé.
Les sites infectieux primitifs sont plus souvent cutanés ou des tissus mous qu'au niveau d'autres sites. Contrairement au syndrome de choc toxique staphylococcique, le syndrome de choc toxique streptococcique est plus susceptible d'entraîner un syndrome de détresse respiratoire aigu (ARDS/SDRA [acute respiratory distress syndrome]) et moins susceptible d'entraîner une réaction cutanée caractéristique.
Le syndrome de choc toxique à S. pyogenes est défini comme toute infection à streptocoques bêta-hémolytique du groupe A associée à un choc et à une défaillance d'organe.
Les facteurs de risque de syndrome de choc toxique à streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A comprennent les facteurs suivants:
Trauma mineur
Procédures chirurgicales
Infections virales (p. ex., varicelle)
Utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
Diabète
Trouble lié à l'abus d'alcool
Âge (enfants et personnes âgées)
Le taux de mortalité du syndrome de choc toxique streptococcique est d'environ 28% chez les enfants (4) et jusqu'à 45% chez les adultes (3), et il est plus élevé chez les patients présentant une fasciite nécrosante.
Références générales
1. Atchade E, De Tymowski C, Grall N, Tanaka S, Montravers P. Toxic Shock Syndrome: A Literature Review. Antibiotics (Basel). 2024;13(1):96. Published 2024 Jan 18. doi:10.3390/antibiotics13010096
2. Schlievert PM, Davis CC. Device-associated menstrual toxic shock syndrome. Clin Microbiol Rev. 33(3):e00032-19, 2020. doi: 10.1128/CMR.00032-19
3. Stevens DL, Bryant AE. Necrotizing Soft-Tissue Infections. N Engl J Med. 2017;377(23):2253-2265. doi:10.1056/NEJMra1600673
4. Adalat S, Dawson T, Hackett SJ, Clark JE; In association with the British Paediatric Surveillance Unit. Toxic shock syndrome surveillance in UK children. Arch Dis Child. 2014;99(12):1078-1082. doi:10.1136/archdischild-2013-304741
Symptomatologie du syndrome de choc toxique
Le début du syndrome de choc toxique est brutal, avec (1):
Fièvre (39 à 40,5° C, qui reste élevée)
Hypotension (pression artérielle systolique < 90 mm Hg chez l'adulte ou inférieure au cinquième percentile pour l'âge chez l'enfant; elle peut être réfractaire)
Une érythrodermie maculaire diffuse (surtout sur les paumes et les plantes, 1 à 2 semaines après le début)
Atteinte d'au moins 3 autres systèmes d'organes (p. ex., gastro-intestinal, musculaire, muqueuses, rénal, hépatique, hématologique, système nerveux central)
Le syndrome de choc toxique staphylococcique est susceptible d'entraîner des vomissements, une diarrhée, une myalgie et une élévation de la créatine kinase (CK), une mucite, des lésions hépatiques, une thrombopénie et une confusion. L'éruption due au syndrome de choc toxique staphylococcique entraîne souvent une desquamation, particulièrement sur les paumes et les plantes, entre 3 et 7 jours après le début de l'infection.
Le syndrome de choc toxique streptococcique déclenche souvent un syndrome de détresse respiratoire (ARDS [acute respiratory distress syndrome]), une coagulopathie et des lésions hépatiques, et est davantage susceptible de provoquer une fièvre élevée, une sensation de malaise, une tachycardie, une tachypnée et une douleur sévère au niveau du site d'atteinte des tissus mous (2).
L'insuffisance rénale est fréquente dans les 2 types syndrome de choc toxique.
Bien que les cas moins graves de syndrome de choc toxique staphylococcique soient assez fréquents, les cas graves de syndrome de choc toxique peuvent évoluer en 48 heures vers une syncope, une nécrose tissulaire, un choc, une coagulation disséminée, une défaillance multisystémique et la mort.
Le syndrome de choc toxique staphylococcique provoque une éruption érythémateuse diffuse. Plus tard au cours de l'évolution de la maladie, l'éruption desquame, surtout sur les paumes et les plantes.
Références pour la symptomatologie
1. Lappin E, Ferguson AJ. Gram-positive toxic shock syndromes. Lancet Infect Dis. 2009;9(5):281-290. doi:10.1016/S1473-3099(09)70066-0
2. Atchade E, De Tymowski C, Grall N, Tanaka S, Montravers P. Toxic Shock Syndrome: A Literature Review. Antibiotics (Basel). 2024;13(1):96. doi:10.3390/antibiotics13010096
Diagnostic du syndrome de choc toxique staphylococcique
Principalement l'anamnèse et l'examen clinique
Cultures
Parfois, imagerie (IRM, TDM)
Parfois mesure adjuvante des anticorps anti-TSST-1
Le diagnostic de syndrome de choc toxique est clinique et est établi par isolement du microrganisme dans les hémocultures (pour Streptococcus) ou au niveau du site infectieux.
Les prélèvements pour culture doivent être effectués sur toutes les lésions, le nez (pour les staphylocoques), la gorge (pour les streptocoques), le vagin (pour les deux), des hémocultures doivent aussi être pratiquées. La confirmation microbiologique n'est pas requise pour le diagnostic, car les hémocultures sont souvent négatives, mais l'isolement de l'un ou l'autre organisme à partir d'un site pertinent est en faveur du diagnostic.
Une IRM ou une TDM des tissus mous permettent de localiser les sites infectieux.
Une surveillance continue des fonctions rénales, hépatiques, médullaires et cardiopulmonaires est nécessaire.
La mesure des taux d'anticorps anti-TSST-1 afin d'évaluer la séroconversion après l'infection peut aider à orienter les efforts de développement de vaccins et finalement prévenir la récurrence (1).
Diagnostic différentiel
Le syndrome du choc toxique ressemble à la maladie de Kawasaki, mais celle-ci est observée habituellement chez l'enfant de < 5 ans et ne provoque pas de choc, d'azotémie ou de thrombopénie; l'éruption cutanée est maculopapuleuse.
Le diagnostic différentiel comprend la scarlatine, le syndrome de Reye, le syndrome d'épidermolyse staphylococcique, la méningococcémie, la fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses, la leptospirose et les maladies exanthématiques virales. Ces troubles seront éliminés par les différences cliniques caractéristiques, les résultats des cultures, ainsi que les tests sérologiques.
Référence pour le diagnostic
1. Weiss S, Holtfreter S, Meyer TC, et al. Toxin exposure and HLA alleles determine serum antibody binding to toxic shock syndrome toxin 1 (TSST-1) of Staphylococcus aureus. Front Immunol. 2023;14:1229562. doi:10.3389/fimmu.2023.1229562
Traitement du syndrome de choc toxique
Mesures locales (décontamination des sites infectés, incluant débridement et irrigation)
Une restauration volémique et une assistance circulatoire
Antibiothérapie empirique (p. ex., bêta-lactamines ou vancomycine, daptomycine, ou ceftaroline (si SARM prouvé ou suspecté) plus inhibiteurs de protéines (clindamycine ou linézolide) en attendant les résultats de culture
Traitement adjuvant par immunoglobulines intraveineuses (IgIV)
En cas de suspicion de syndrome de choc toxique, les patients doivent être hospitalisés immédiatement et recevoir un traitement intensif. Les tampons, les diaphragmes et autres corps étrangers suspectés de contribuer à l'infection doivent être retirés immédiatement.
Les sites primitifs suspects doivent être soigneusement désinfectés. La décontamination comprend:
Réinspection et irrigation des plaies chirurgicales, même si elles semblent saines
Débridement répété des tissus dévitalisés
Irrigation par du sérum physiologique des sites potentiels naturellement colonisés (sinus, vagin)
Un apport hydroélectrolytique pour prévenir ou traiter l'hypovolémie, l'hypotension et le choc est effectué. La perte liquidienne dans les tissus pouvant se produire dans tout l'organisme (en raison du syndrome systémique de fuite capillaire et d'hypoalbuminémie), le choc qui s'ensuit peut être profond et résistant. Une restauration volémique massive et une assistance circulatoire, ventilatoire, et/ou une hémodialyse sont parfois nécessaires.
Les infections évidentes doivent être traitées par des antibiotiques. En attendant les résultats des cultures, il convient de traiter par la clindamycine ou le linézolide (pour supprimer la production de toxine), plus vancomycine, la daptomycine, le linézolide (si la clindamycine est utilisée), ou la ceftaroline de manière empirique, car ces antibiotiques couvrent les micro-organismes étiologiques les plus probables. Si un agent pathogène est isolé sur les cultures, le traitement antibiotique est ajusté tel que nécessaire, comme suit:
En cas de streptocoques du groupe A: clindamycine ou linézolide plus une bêta-lactamine
En cas de S. aureus sensible à la méthicilline (SASM): clindamycine plus oxacilline ou nafcilline
En cas de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [SARM]: vancomycine ou daptomycine et clindamycine ou linézolide, en fonction de la sensibilité
Une antibiothérapie administrée pendant la phase aiguë de la maladie peut également éradiquer le foyer pathogène et éviter les récidives. Une immunisation passive contre les toxines responsables du syndrome de choc toxique par des IgIV s'est avérée utile dans les cas sévères des 2 types de syndrome de choc toxique et dure quelques semaines, mais la maladie peut ne pas induire d'immunité active et les récidives sont donc possibles. Elle peut réduire la mortalité du syndrome de choc toxique staphylococcique, surtout lorsqu'elle est coadministrée avec la clindamycine (1).
Si un test de séroconversion de la réponse des anticorps sériques au TSST-1 dans les sérums appariés en phase aiguë et de convalescence est négatif, les femmes qui ont eu un syndrome de choc toxique staphylococcique peuvent présenter un risque génétiquement plus élevé de syndrome de choc toxique en raison de leur association avec les gènes HLA de classe II (2). Ces femmes (qui ont des risques génétiques plus élevés et une séroconversion négative) doivent s'abstenir d'utiliser des tampons et des coupelles menstruelles, des capes cervicales, des éponges contraceptives, des dispositifs intra-utérins, des diaphragmes et des pessaires. Conseiller à toutes les femmes, indépendamment de la présence d'anticorps anti-TSST-1 (toxic shock syndrome toxin), de changer souvent de tampons ou autres matériaux insérés dans le vagin ou d'utiliser plutôt des serviettes hygiéniques et éviter les tampons hyperabsorbants, semble prudent.
En cas de portage nasal de S. aureus, la mupirocine topique peut être utilisée. En cas de colonisation extra-nasale, des bains antiseptiques supplémentaires à la chlorhexidine pendant 1 semaine sont justifiés.
Références pour le traitement
1. Parks T, Wilson C, Curtis N, Norrby-Teglund A, Sriskandan S. Polyspecific Intravenous Immunoglobulin in Clindamycin-treated Patients With Streptococcal Toxic Shock Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Infect Dis. 2018;67(9):1434-1436. doi:10.1093/cid/ciy401
2. Weiss S, Holtfreter S, Meyer TC, et al. Toxin exposure and HLA alleles determine serum antibody binding to toxic shock syndrome toxin 1 (TSST-1) of Staphylococcus aureus. Front Immunol. 2023;14:1229562. doi:10.3389/fimmu.2023.1229562
Points clés
Le syndrome de choc toxique est causé par des souches de Staphylococcus aureus et de Streptococcus pyogenes productrices d'exotoxine.
Bien que classiquement décrit comme survenant lors de l'utilisation du tampon, le syndrome de choc toxique peut survenir après de nombreuses infections des tissus mous staphylococciques ou streptococciques.
L'apparition des symptômes est soudaine; les symptômes comprennent une hyperthermie, une hypotension (qui peut être réfractaire), une éruption érythémateuse diffuse et une atteinte polyviscérale.
Fournir des soins de support énergiques, et décontaminer et/ou débrider le site source.
Administrer des antibiotiques (p. ex., bêta-lactamines, vancomycine, daptomycine ou ceftaroline si le SARM est prouvé ou suspecté) plus de la clindamycine ou du linézolide en attendant la culture et l'antibiogramme.
Administrer des immunoglobulines IV en cas de syndrome de choc toxique sévère.