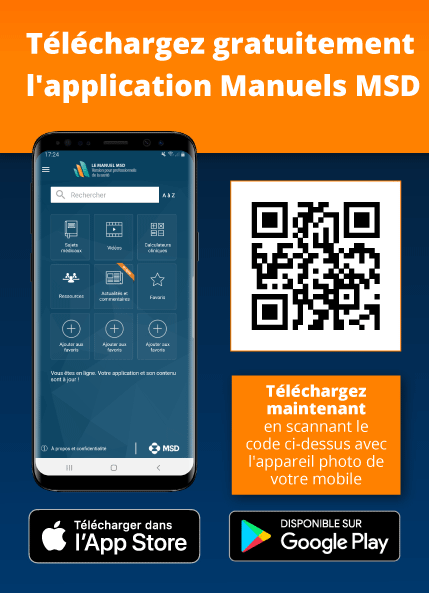Le syndrome d'hyperventilation correspond à une dyspnée et à une tachypnée liées à l'anxiété souvent accompagnées de symptômes généraux. Il peut être aigu ou chronique. Le diagnostic est un diagnostic d'exclusion. Le traitement est symptomatique.
Le syndrome d'hyperventilation est le plus souvent observé chez les jeunes femmes mais peut affecter les deux sexes à n'importe quel âge. Il est parfois déclenché par des événements émotionnels stressants. Le syndrome d'hyperventilation est différent du trouble panique, bien que les 2 troubles se recouvrent; environ la moitié des patients souffrant de trouble panique ont un syndrome d'hyperventilation et un quart à la moitié des patients qui ont un syndrome d'hyperventilation ont un trouble panique (1).
Référence
1. Cowley DS, Roy-Byrne PP. Hyperventilation and panic disorder. Am J Med 1987;83(5):929-937. doi:10.1016/0002-9343(87)90654-1
Symptomatologie du syndrome d'hyperventilation
Les patients qui ont un syndrome d'hyperventilation présentent initialement une dyspnée parfois si importante qu'ils l'évoquent comme une sensation de suffocation. Elle peut être accompagnée d'une agitation et d'un sentiment de terreur ou de symptômes somatiques tels qu'une douleur thoracique, des paresthésies (périphériques et péribuccales), une tétanie périphérique (p. ex., rigidité des doigts ou des bras), une lipothymie ou une syncope, ou parfois une association de ces symptômes. La tétanie est due à l'alcalose respiratoire qui entraîne à la fois une hypophosphatémie et une hypocalcémie. À l'examen, les patients peuvent paraître anxieux et/ou, tachypnéïques; l'examen du poumon est sans particularité.
Diagnostic du syndrome d'hyperventilation
Examens complémentaires pour exclure d'autres diagnostics (radiographie de thorax, ECG, oxymétrie de pouls)
Le syndrome d'hyperventilation est un diagnostic d'exclusion; la difficulté est d'utiliser judicieusement les examens complémentaires et les ressources possibles pour différencier ce syndrome de diagnostics plus sévères.
Les examens de base comprennent
Oxymétrie de pouls
Rx thorax
ECG
Dans le syndrome d'hyperventilation, l'oxymétrie de pouls montre une saturation en oxygène égale à ou proche de 100%. La radiographie de thorax est normale. Un ECG est réalisé pour rechercher une ischémie cardiaque, bien que le syndrome d'hyperventilation puisse lui-même entraîner un sous-décalage du segment ST, une inversion de l'onde T et un allongement de l'intervalle QT.
La mesure des gaz du sang artériel est nécessaire lorsque d'autres causes d'hyperventilation sont suspectées, comme une acidose métabolique.
Le syndrome d'hyperventilation est parfois indiscernable de l'embolie pulmonaire et il peut être nécessaire de réaliser un bilan de recherche d'une embolie pulmonaire (p. ex., D-dimère, scintigraphie de ventilation/perfusion, angio-TDM).
Traitement du syndrome d'hyperventilation
Conseil de soutien
Parfois, traitement psychiatrique ou psychologique
Le traitement consiste à rassurer. Certains préconisent d'apprendre au patient l'expiration maximale et la respiration diaphragmatique. La plupart des patients doivent être traités pour des troubles de l'humeur ou des pathologies anxieuses sous-jacentes; la prise en charge comprend une thérapie cognitive, les techniques de relaxation et/ou des médicaments (p. ex., anxiolytiques, antidépresseurs ou lithium), ou une association de ces techniques.